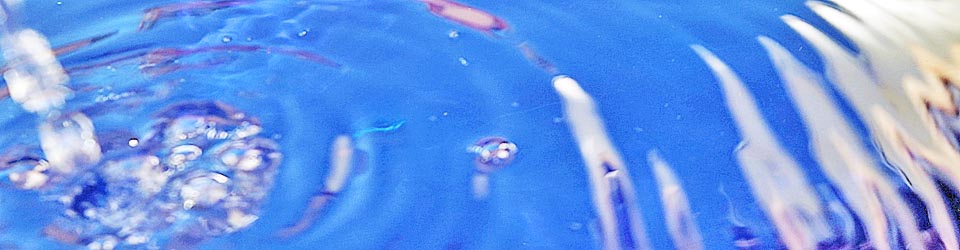par Andreas Peglau[1)
(Il s’agit d’une traduction automatique réalisée par DeepL, que je n’ai pas vérifiée. Je vous prie de m’excuser pour les erreurs qui s’y trouvent certainement. Lors de la traduction, DeepL a également supprimé tous les liens vers les notes de fin.)
Depuis que l’humanité existe…
« On entend par guerre un conflit organisé et mené avec des moyens considérables, à l’aide d’armes et de violence, auquel participent des collectifs agissant de manière planifiée. L’objectif des collectifs impliqués est de faire valoir leurs intérêts. […] Les actes de violence commis à cette fin visent délibérément l’intégrité physique des individus adverses et entraînent ainsi la mort et des blessures. » (Wikipedia)[2]
Le philosophe grec antique Héraclite (vers 520 avant J.-C. – 460 avant J.-C.) a laissé cette phrase : « La guerre est le père de tous. »[3] En 1642, le philosophe anglais Thomas Hobbes a écrit que « la guerre de tous contre tous » était l’état originel, l’état de nature.[4] Près de 300 ans plus tard, Sigmund Freud s’est inspiré d’une autre citation de Hobbes pour affirmer que « l’homme est un loup pour l’homme », une « bête sauvage qui ignore la pitié envers ses semblables », en se basant sur une « hostilité primaire » – c’est-à-dire innée et prédéterminée – « des hommes les uns envers les autres ».[5]
Si tel était le cas, nous n’aurions pas à nous demander comment les guerres éclatent ou quels intérêts elles servent : cela serait en quelque sorte inscrit dans nos gènes… Cela signifierait également que les guerres seraient pratiquement inévitables à long terme. Et si elles pouvaient être évitées, ce ne serait qu’au prix de la suppression de notre vraie nature, de nos « dispositions ».
Aujourd’hui encore, la thèse de la guerre comme état originel, quasi « naturel », est défendue. En voici deux exemples:
En 2009, lors de la remise du prix Nobel de la paix, Barack Obama, le président américain qui allait être responsable de plus de jours de guerre que tous ses prédécesseurs, a déclaré :[6] « La guerre est apparue, sous une forme ou une autre, avec le premier homme sur Terre. »[7]
Sur le site web du « Zukunftsinstitut » (Institut du futur) fondé par le futurologue Matthias Horx, on pouvait lire en 2024 : « Depuis que les êtres humains existent, il y a des conflits armés. »[8] On prétendait même le savoir avec certitude :
« Les sociétés les plus violentes sont – ou étaient – celles que nous qualifions plutôt de « pacifiques ». Les sociétés de chasseurs-cueilleurs avaient les taux de meurtres les plus élevés, et dans la plupart des régions du monde, des guerres tribales faisaient rage sans fin. À l’état naturel, on prenait ce qu’on pouvait, les membres d’une autre tribu n’étaient pas considérés comme « les nôtres » et l’hésitation à tuer était peu développée, surtout dans les situations de pénurie. »[9]
Face à cet « état naturel primitif », les démocraties bourgeoises, où la pauvreté, l’exploitation, l’oppression et le bellicisme sont réglementés par la loi, doivent – ou devraient – apparaître comme une pure rédemption.
Voyage dans la préhistoire
Jetons donc un coup d’œil à l’état actuel des connaissances sur l’évolution de l’humanité. Étant donné que l’archéologie s’appuie souvent sur des suppositions et des « analogies »[10] en raison du nombre limité de preuves, qu’une grande partie des thèses sont controversées parmi les experts eux-mêmes et qu’une seule nouvelle découverte suffit souvent à bouleverser le tableau, certaines des informations suivantes, en particulier celles relatives à la datation, n’ont qu’une validité provisoire. J’espère que les conclusions que j’en tire resteront valables à plus long terme.
On suppose actuellement que la séparation entre la lignée qui a donné naissance à l’homme moderne et celle qui a donné naissance au chimpanzé actuel s’est produite il y a environ six millions d’années[11]. Il en est d’abord résulté des êtres ressemblant encore relativement à des singes, également appelés « préhumains ». On parle des « hommes primitifs » et des « premiers hommes », premiers représentants de l’espèce « Homo », apparus il y a deux à trois millions d’années.[12] L’existence de l’« homme anatomiquement moderne », l’Homo sapiens, est prouvée depuis environ 300 000 ans.[13]
Tout le monde s’accorde à dire que l’utilisation du feu a contribué au processus de l’évolution humaine. Le site web « Planet Wissen » nous apprend à ce sujet :[14]
« Certaines découvertes indiquent que nos ancêtres […] utilisaient déjà la puissance du feu il y a environ 1,5 million d’années. Cependant, la question de savoir à partir de quand l’homme a réussi à allumer le feu de manière autonome fait encore l’objet de vifs débats parmi les chercheurs. Beaucoup partent du principe que les Néandertaliens en étaient capables il y a 40 000 ans à l’aide de silex. »
Si ces chiffres sont exacts, nos ancêtres auraient manipulé le feu pendant près d’un million et demi d’années sans découvrir comment le faire eux-mêmes. Il n’est donc pas surprenant que d’autres scientifiques, comme l’historien James C. Scott, situent cette découverte à une date bien plus ancienne : il y a environ 400 000 ans.[15]
400 000 ou 40 000 ans ? Derrière cette imprécision remarquable de 360 000 ans se cache un problème fondamental de la recherche sur nos premières étapes de développement : nous avons certes beaucoup d’hypothèses sur la plus grande partie de l’existence des êtres de plus en plus humains, mais nous en savons extrêmement peu.
Aucune déclaration représentative

Dans leur livre Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit (Les débuts. Une nouvelle histoire de l’humanité), publié en 2021, l’anthropologue David Graeber et l’archéologue David Wengrow résument l’état actuel de la recherche. Ils écrivent :
« Pour notre préhistoire, nous disposons de très peu de découvertes. Ainsi, il y a […] des milliers d’années, les seules traces disponibles de l’activité hominidée se composent d’une seule dent ou peut-être de quelques éclats de silex taillés. […]
À quoi ressemblaient ces sociétés préhumaines ? Nous devrions au moins être honnêtes à ce stade et admettre que nous n’en avons pas la moindre idée. […]
Pour la plupart des périodes, nous ne savons même pas comment étaient construits les humains en dessous du larynx, sans parler de la pigmentation, de l’alimentation et de tout le reste. »[16]
En 2024, l’archéologue Harald Meller, l’historien Kai Michel et le biologiste évolutionniste Carel van Schaik ont confirmé : « Nous avons affaire à un nombre infime d’ossements humains conservés. »[17] Une estimation citée par eux évaluait à 3 000 le nombre de « restes d’Homo sapiens datant de plus de 10 000 ans » découverts.[18]
Le nombre total d’humains préhistoriques, primitifs, anciens et actuels qui ont peuplé la Terre jusqu’à cette date est estimé, de manière forcément très spéculative, à plus de sept milliards.[19] Comme la population d’êtres humanoïdes a apparemment augmenté très lentement au début, la grande majorité d’entre eux appartenaient en tout cas au groupe des Homo sapiens.[20]
Quelques milliers de restes humains dispersés à travers la moitié de la Terre, dont le nombre diminue avec le temps : cela montre à quel point toutes les conclusions généralisées sur les premiers êtres humains et les premiers hommes reposent sur des bases fragiles. On ne peut en aucun cas affirmer que les fragments de squelettes de quelques individus permettent de tirer des conclusions représentatives sur de grands groupes d’êtres humains vivants. Les dents et les os du crâne, qui constituent la majeure partie de ces découvertes, ne fournissent de toute façon aucune information sur les aspects psychosociaux ou l’état mental et émotionnel de leurs anciens propriétaires. Elles ne permettent donc pas non plus de savoir s’ils étaient belliqueux ou pacifiques.
Les premières « preuves directes de ce que nous appelons aujourd’hui […] la « culture » ne remontent » qu’à « 100 000 ans ». Et ce n’est que depuis près de 50 000 ans que ces preuves deviennent progressivement plus fréquentes.[21]
Or, l’Homo sapiens existait déjà depuis au moins 250 000 ans. Mais même ce que nous pensons savoir sur l’état psychique, les motivations, les objectifs et les comportements sociaux des êtres humains au cours de ces 250 000 années repose, à l’exception des cinq derniers millénaires, presque exclusivement sur des hypothèses plus ou moins plausibles.
Le caractère provisoire de ces hypothèses a été une fois de plus mis en évidence par l’annonce, le 6 juin 2023, selon laquelle des ancêtres de l’homme auraient déjà enterré leurs proches il y a 200 000 ans. Jusqu’à présent, seuls les Néandertaliens et les Homo sapiens étaient capables de le faire, et ce depuis seulement 100 000 ans. Selon l’article, ces découvertes « remettent en question la compréhension actuelle de l’évolution humaine, selon laquelle seul le développement d’un cerveau plus gros a permis des activités complexes telles que l’enterrement des morts ».[22]
Une compilation concise des découvertes archéologiques antérieures et des hypothèses qui en ont été tirées se trouve dans le livre Weltgeschichte der Psychologie (Histoire mondiale de la psychologie), rédigé par le psychologue et anthropologue Hannes Stubbe.[23]
La bienveillance plutôt que le meurtre
R. Brian Ferguson, un autre anthropologue, a examiné dans divers sites des centaines de squelettes d’Homo sapiens datant de plus de 10 000 ans afin de déterminer s’ils présentaient des traces de violence interpersonnelle. Résultat : ce n’était le cas que pour environ trois douzaines d’entre eux. Cela signifie qu’il n’a trouvé aucune preuve archéologique de guerre remontant à plus de 10 000 ans. De plus, les actes de violence n’ont pas nécessairement été commis intentionnellement..[24]

En effet, il existe également des indices d’actes de violence interhumaine dans la préhistoire ; les plus anciens remontent à environ 430 000 ans.[25] Après avoir passé au crible les trois millions d’années qui ont suivi l’apparition de l’espèce Homo dans leur ouvrage Die Evolution der Gewalt (L’évolution de la violence), Meller, Michel et van Schaik concluent toutefois qu’ils « n’ont omis aucune trace significative » et qu’« il n’existe même pas une poignée de preuves de meurtres intentionnels ».[26]
Mais même si ces meurtres étaient des assassinats, ce qui ne peut être établi en l’absence de témoins oculaires, un assassinat n’est pas une guerre. Et un seul meurtrier – sur lequel, contrairement à la victime, on ne dispose d’aucune information – ne peut être considéré comme représentatif de la population humaine de l’époque. Harald Meller et ses coauteurs ajoutent :
« Si l’on cherche des preuves préhistoriques de guerre, de meurtre et d’homicide, on trouve plutôt des indices de soins et d’attention. Les découvertes paléoarchéologiques attestent que les hommes s’entraidaient et se soutenaient mutuellement, sans quoi de nombreuses blessures auraient été synonymes de condamnation à mort. »
Ils citent l’exemple d’un Néandertalien, également décédé il y a environ 430 000 ans, qui « souffrait d’une série de maladies dégénératives, de traumatismes, d’un raccourcissement du bras droit et probablement de la cécité de l’œil gauche ainsi que d’une surdité sévère » , mais qui a néanmoins atteint « quarante à cinquante ans », ce qui n’était concevable qu’avec « l’aide quotidienne » de son groupe, y compris le traitement de ses blessures.[27]
Critères pour définir une « guerre »
À cela s’ajoute le fait que tout acte de violence intentionnel entre êtres humains, et même tout conflit armé, ne constitue pas nécessairement une guerre. Pour reprendre encore une fois Wikipédia:
« Une difficulté fondamentale dans la classification des guerres est de déterminer à partir de quand une guerre peut être qualifiée comme telle. Dans les analyses politiques et scientifiques, on distingue souvent les conflits armés et les guerres. Un conflit armé est un affrontement armé sporadique, plutôt fortuit et sans justification stratégique entre des parties belligérantes. »[28]
Dans les « grands projets de recherche », poursuit l’article, « le seuil de 1 000 morts par an est considéré comme un indicateur approximatif permettant de déterminer qu’un conflit armé dégénère en guerre ». D’autres « définitions de la guerre » exigent en outre « un minimum d’action planifiée et organisée de la part d’au moins l’une des parties en conflit » ou « qu’au moins l’une des parties belligérantes soit un État qui participe au conflit avec ses forces armées ».[29]
Une découverte considérée depuis longtemps comme la plus ancienne preuve d’un conflit armé ne répondait au mieux qu’en partie aux critères susmentionnés. R. Brian Ferguson rapporte à propos des fouilles menées dans l’actuel Soudan :
« Ce cimetière, connu sous le nom de site 117, a été découvert au milieu des années 1960 lors d’une expédition dirigée par Fred Wendorf, archéologue à la Southern Methodist University de Dallas, au Texas, et est estimé, selon des estimations approximatives, entre 12 000 et 14 000 ans. Il contenait 59 squelettes bien conservés, dont 24 ont été trouvés en étroite relation avec des morceaux de pierre interprétés comme des fragments de projectiles. »[30]

À ce jour, 61 morts d’âges différents et des deux sexes ont été retrouvés ; 41 squelettes présentent des blessures.[31] Cependant, il n’a pas été possible de déterminer si ces morts ont été enterrés en même temps ou au cours d’une longue période. Dans son livre Als der Mensch den Krieg erfand (Quand l’homme a inventé la guerre), le préhistorien Dirk Husemann indique que Fred Wendorf a découvert « à proximité un autre site funéraire datant de la même époque » dans lequel « aucun cadavre ne présentait de blessures ». Il était donc également possible que le site 117 ait été utilisé intentionnellement pour « n’enterrer que ceux qui étaient morts de mort violente ».[32] Il s’avère cependant aujourd’hui que « beaucoup de ces personnes présentaient des blessures » – principalement causées par des flèches ou des lances – « qui avaient déjà cicatrisé au moment de leur mort » ;[33] cela concernait les trois quarts des adultes.
Le jugement de Dirk Husemann semble donc juste : un massacre est « à exclure ».[34] Toutefois, ces découvertes attestent « de violences interhumaines récurrentes ».[35]
5,988 millions d’années sans trace de guerre
Mais même si, malgré notre ignorance totale des circonstances exactes, nous voulions considérer les blessures et les meurtres commis il y a environ 12 000 ans au Soudan comme des signes de guerre, cela signifierait, en partant de six millions d’années d’existence humaine, qu’il n’y a aucune preuve de guerre pendant 5 988 millions d’années, soit 99,98 % de cette période. Si nous prenons plutôt comme référence les trois millions d’années qui ont suivi l’apparition des premiers hominidés, c’est-à-dire de l’espèce Homo, nous pouvons constater la même chose pour 99,96 % de cette période. Et même si nous ne prenons en comparaison que les 300 000 années d’existence de l’Homo sapiens qui ont été prouvées jusqu’à présent, nous pouvons affirmer que pour 96 % de la durée de vie des « humains anatomiquement modernes », il n’existe aucune preuve d’un quelconque conflit armé. Il en va de même pour les Néandertaliens, qui existaient déjà « en tant qu’espèce distincte » il y a 450 000 ans.[36]
Harald Meller, Kai Michel et Carel van Schaik déclarent également qu’il n’existe « à ce jour aucune trace archéologique de guerre ou même de conflits sporadiques entre groupes » pendant cette période infiniment longue. L’archéologie serait « sans équivoque : du point de vue de l’histoire de l’humanité, le massacre collectif et organisé semble être un phénomène récent ».[37]

Pourquoi, demandent le psychologue Christopher Ryan et la psychiatre Cacilda Jethá dans leur livre Sex. Die wahre Geschichte (Sexe. La véritable histoire), nos ancêtres auraient-ils dû entreprendre des migrations épuisantes sur une planète fertile, essentiellement inhabitée[38] et dotée de ressources inépuisables,[39] pour tuer d’autres êtres humains ou se faire tuer ? Cela concorde avec le fait qu’aucune scène de guerre n’ait été découverte sur les peintures rupestres préhistoriques, qui se comptent désormais par milliers.[40]
Ce n’est qu’il y a environ 7 000 ans que plusieurs fosses communes ont été découvertes, que les experts s’accordent largement à considérer comme la preuve de massacres guerriers.[41]
Les premières représentations picturales, sur lesquelles des archers semblent s’affronter,[42] sont actuellement datées d’environ 5 000 ans.[43]
On peut supposer que les guerres étaient avant tout le résultat de l’émergence de structures sociales autoritaires, accompagnées d’une répartition inégale des richesses, peut-être exacerbée par des catastrophes naturelles et leurs multiples répercussions.[44]
Retenez donc ce qui suit : des phrases telles que celles citées au début de cet article, prononcées par Barack Obama ou par le „Zukunftsinstitut“ (« Depuis que les hommes existent, il y a des conflits armés »), ne sont en aucun cas vérifiables et sont donc également non scientifiques.
Ceux qui propagent néanmoins de telles idées doivent se demander sur quelle base et avec quelle motivation ils le font. Dans le cas d’Obama, l’idée vient facilement à l’esprit : présenter les guerres comme quelque chose de profondément humain a dû lui faciliter la tâche pour en déclencher lui-même sans avoir mauvaise conscience.
De même, les bellicistes actuels au sein des gouvernements et des médias de masse ont tout intérêt à mettre en avant une prétendue propension innée à la destruction et au meurtre, voire une envie, afin de nous rendre acceptable la « capacité guerrière » qu’ils souhaitent nous inculquer, selon la devise : « C’est ce que vous voulez de toute façon ! »
En principe, celui qui croit en la nature destructrice de l’être humain s’épargne la question dérangeante de savoir ce qui rend les hommes « mauvais ».
Les limites de la connaissance
Le manque de possibilités d’évaluation objective de l’histoire primitive de l’humanité signifie bien sûr aussi que nous ne pouvons pas prouver que l’humanité a connu des débuts entièrement pacifiques, ni qu’elle a connu un état originel paradisiaque, communiste ou matriarcal. En 1996, après des recherches approfondies, les archéologues Brigitte Röder, Juliane Hummel et Brigitta Kunz ont conclu que le matriarcat « ne peut être ni prouvé ni réfuté par des sources archéologiques. L’un des plus grands problèmes de l’archéologie est qu’elle ne dispose toujours pas de clé pour comprendre le monde des sociétés passées ».[45]
Pour les 50 000 dernières années, les peintures rupestres et les représentations figuratives, qui doivent être interprétées, offrent certes un aperçu de cet univers mental. Cependant, une « clé » plus fiable n’a été développée que grâce à la possibilité de consigner les langues écrites de manière durable, par exemple sous forme de cunéiformes, il y a environ 5 000 ans.[46] Le fait que même cette clé n’est pas parfaitement définie, que les traditions écrites sont souvent fausses, déformées et presque toujours incomplètes, est déjà souligné par l’affirmation justifiée selon laquelle l’histoire est écrite par les vainqueurs. Dans le cas célèbre de l’île de Pâques, ce sont les conquérants et les marchands d’esclaves qui ont imputé aux indigènes les destructions qu’ils avaient eux-mêmes causées et initiées parmi eux.[47]
 Les diffamations à l’encontre des cultures « primitives » sont nombreuses dans l’étude de l’histoire. Ainsi, les Néandertaliens ont été et sont encore parfois décrits comme des « extraterrestres musclés, « intellectuellement limités et d’une stupidité et d’une inculture difficilement surpassables »[48] – bien que de nombreuses découvertes aient depuis longtemps confirmé que cette espèce humaine disparue il y a seulement environ 40 000 ans était l’égale de l’Homo sapiens dans tous les aspects essentiels, tout aussi « humain » que l’Homo sapiens et qu’il s’est même croisé avec lui dans certains cas.[49] Hannes Stubbe note : « Même si certains scientifiques ont du mal à l’admettre, nous devons aujourd’hui accepter l’homme de Néandertal comme un être humain à part entière, doté de toutes les fonctions mentales, psychiques et sociales, de toutes les forces et compétences […] ».[50] Et les Néandertaliens avaient également un cerveau plus gros que le nôtre…[51]
Les diffamations à l’encontre des cultures « primitives » sont nombreuses dans l’étude de l’histoire. Ainsi, les Néandertaliens ont été et sont encore parfois décrits comme des « extraterrestres musclés, « intellectuellement limités et d’une stupidité et d’une inculture difficilement surpassables »[48] – bien que de nombreuses découvertes aient depuis longtemps confirmé que cette espèce humaine disparue il y a seulement environ 40 000 ans était l’égale de l’Homo sapiens dans tous les aspects essentiels, tout aussi « humain » que l’Homo sapiens et qu’il s’est même croisé avec lui dans certains cas.[49] Hannes Stubbe note : « Même si certains scientifiques ont du mal à l’admettre, nous devons aujourd’hui accepter l’homme de Néandertal comme un être humain à part entière, doté de toutes les fonctions mentales, psychiques et sociales, de toutes les forces et compétences […] ».[50] Et les Néandertaliens avaient également un cerveau plus gros que le nôtre…[51]
Martin Kuckenburg a rendu justice au Néandertalien en tant que « premier Européen » dans plusieurs publications.[52]
En ce qui concerne la « capacité à faire la guerre », deux autres exemples de déformation de la réalité méritent d’être soulignés. Seule une manipulation flagrante des données, désormais révélée en détail[53], a permis au psychologue Steven Pinker d’affirmer qu’autrefois, « la violence collective […] avait toujours existé partout »[54] – et d’en déduire une idéalisation des structures sociales bourgeoises et capitalistes.[55] L’anthropologue Napoleon Chagnon[56] a agi de manière particulièrement effrontée en offrant d’abord des haches et des machettes au peuple Yanomami en 1964, puis en affirmant dans des best-sellers, sur la base de diverses fausses déclarations, qu’ils étaient extrêmement violents. En 1995, les Yanomami lui ont interdit l’accès à leur territoire pour ses calomnies persistantes.[57]
Mais Chagnon, Pinker bien sûr, continuent d’être considérés comme les témoins clés de la brutalité des peuples indigènes et de leur méchanceté innée.

L’historien Rutger Bregman a rassemblé des exemples de l’hypocrisie du « récit standard » du « sauvage méchant » que seule une « bonne » civilisation (occidentale) doit rendre socialement acceptable, et a examiné de manière critique des expériences, des études et des publications prétendument scientifiques sur l’image de l’homme.
Il arrive à la conclusion que l’être humain est « fondamentalement bon », comme le titre de son livre l’indique.[58]
Le manque de données sérieuses sur la (pré)histoire de l’humanité décrit ci-dessus signifie-t-il que nous ne pouvons pas répondre à la question de savoir si nous sommes des guerriers nés ? Si, nous le pouvons.
Une propension innée à la guerre et au meurtre devrait se manifester toujours et partout, ne serait-ce que par le fait qu’elle doit être constamment réprimée. Pour rejeter comme inadmissible l’affirmation selon laquelle nous sommes des guerriers nés, il suffit donc de prouver qu’il en a été ou qu’il en est encore autrement. Cela est tout à fait possible pour les derniers millénaires.[59]
Chasseurs-cueilleurs
En ce qui concerne nos ancêtres proches, qui vivaient de la chasse et de la cueillette – souvent appelés « chasseurs-cueilleurs » –, il faut, selon Harald Meller, Kai Michel et Carel van Schaik, « enterrer le préjugé attribué à Thomas Hobbes[60] » selon lequel leur vie aurait été « solitaire, misérable, répugnante, animale et courte ».[61] Apparemment, ils étaient plus grands « que l’homme moyen d’aujourd’hui » et leur espérance de vie pouvait, selon Christopher Ryan et Cacilda Jethá, se situer entre 70 et 90 ans. L’anthropologue Robert Edgerton estime également qu’en Europe, « les populations urbaines n’ont probablement rattrapé la longévité des chasseurs-cueilleurs qu’au milieu du XIXe siècle, voire au XXe siècle ».[62] Ces nomades étaient apparemment « parfaitement adaptés à leur milieu de vie » et n’avaient guère de raisons de déclencher des conflits pour des ressources insuffisantes.[63]
C’est également ce qu’indiquent les recherches menées par l’anthropologue Douglas P. Fry et le philosophe Patrik Söderberg sur « 148 incidents mortels liés à des agressions » dans 21 communautés de chasseurs-cueilleurs anciennes et plus proches de nous.[64] Ils résument leurs conclusions ainsi : Ces décès avaient généralement pour origine un motif personnel tel que la jalousie ou la vengeance, rarement une querelle familiale, et encore « plus rarement » un conflit « entre communautés politiques ou une guerre ». Dans environ la moitié des communautés, il n’y avait « aucun événement mortel impliquant plus d’un auteur ».[65]

Les sociétés de chasseurs-cueilleurs n’ont pas seulement existé avant les États, fondés pour la première fois il y a environ 6 000 ans, mais parallèlement à eux pendant des millénaires.[66] Comme le montre James C. Scott dans son livre Die Mühlen der Zivilisation[67] (Les moulins de la civilisation), cette coexistence s’explique notamment par le fait que le mode de vie des chasseurs-cueilleurs restait une alternative attrayante à la sédentarisation. En effet, dans les villages fortifiés, l’espérance et la qualité de vie n’ont généralement pas augmenté dans un premier temps, mais ont diminué. Cela s’explique notamment par le fait que la cohabitation étroite entre les hommes et avec les animaux domestiques a provoqué des épidémies et que les gens étaient désormais contraints de se procurer tout ce qui leur était nécessaire à la vie principalement au même endroit.
Mais même dans les grandes villes en formation, il existait des exemples de coexistence pacifique. L’une de ces colonies était Catal Hüyük (ou Çatalhöyük) en Anatolie[68], qui a existé pendant environ 1 500 ans, à partir de 7 400 avant notre ère, et qui couvrait une superficie de 13 hectares et comptait plusieurs milliers d’habitants. L’accès à la nourriture et la possession de biens matériels étaient apparemment répartis de manière assez équitable. Il n’existe aucune trace d’une autorité centrale, encore moins d’une instance répressive, ni de crimes violents ou de combats meurtriers.
Toutefois, seuls 5 % de cette colonie ont été explorés par les archéologues à ce jour[69]. Cela constitue néanmoins une forte indication que les guerres ne sont PAS une constante de l’humanité.
Des recherches ethnologiques menées jusqu’à nos jours permettent en outre de prouver que les représentants de l’espèce Homo sapiens peuvent cohabiter pacifiquement pendant longtemps.
Apprendre des sociétés les plus pacifiques
En 2021, Douglas P. Fry, qui mène depuis longtemps des recherches sur les possibilités de maintien de la paix[70], et le psychologue social Peter T. Coleman ont présenté dans un article leur « projet pour une paix durable » (Sustaining Peace Project)[71].
Depuis 2014, leur groupe composé de psychologues, d’anthropologues, de philosophes, d’astrophysiciens, de spécialistes en sciences de l’environnement et en sciences politiques, ainsi que d’experts en information et en communication s’efforce de « mieux comprendre la paix durable ». Contrairement à ce que laissent entendre les médias, Coleman et Fry écrivent qu’il existe encore aujourd’hui un grand nombre de sociétés qui vivent en paix à l’intérieur de leurs frontières et avec leurs voisins « depuis 50, 100, voire plusieurs centaines d’années ». Cela réfute « la conviction que les êtres humains sont programmés par nature pour la guerre ».[72] Ils citent notamment comme exemples les dix tribus voisines vivant dans le cours supérieur du fleuve Xingu au Brésil, les cantons suisses et la confédération des Iroquois.
Ils ont mis en évid ence les facteurs suivants comme particulièrement propices à la paix : une identité commune supérieure/des activités et des institutions collectives fédératrices/des normes, des valeurs, des rituels et des symboles opposés à la guerre/un « langage de la paix » dans les médias de masse, lorsqu’ils existent/des politiciens, des entrepreneurs, des religieux et des militants qui contribuent à développer et à concrétiser une vision de la paix.[73]
ence les facteurs suivants comme particulièrement propices à la paix : une identité commune supérieure/des activités et des institutions collectives fédératrices/des normes, des valeurs, des rituels et des symboles opposés à la guerre/un « langage de la paix » dans les médias de masse, lorsqu’ils existent/des politiciens, des entrepreneurs, des religieux et des militants qui contribuent à développer et à concrétiser une vision de la paix.[73]
Cela soulève la question de savoir ce qui existe aujourd’hui en Allemagne ou dans l’UE. Coleman et Fry classent également cette dernière comme une société pacifique. Mais leur article date encore de 2021…
Pour approfondir le sujet, le site web du Sustaining Peace Project[74] recommande la lecture du livre de Fry: The Human Potential for Peace.
Anatomie de la destructivité humaine
Dès 1973, le psychanalyste et chercheur en sciences sociales Erich Fromm a compilé des rapports sur différentes ethnies et la qualité de leurs relations sociales. Dans son ouvrage révolutionnaire Anatomie de la destructivité humaine[75], on peut lire que, même dans la seconde moitié du XXe siècle, il existait encore des communautés sociales stables, pacifiques, souvent matriarcales, dans lesquelles il n’était pas nécessaire de réprimer une prétendue pulsion de mort.[76] Fromm résume :
« Alors que nous constatons dans toutes les cultures que les êtres humains se défendent contre une menace pour leur vie en combattant (ou en fuyant), la destructivité et la cruauté sont si minimes dans de nombreuses sociétés que ces grandes différences ne pourraient s’expliquer par une passion « innée ».[77]

À ma connaissance, l’ouvrage de Fromm offre en outre la compilation la plus complète d’arguments issus de la psychanalyse, de la psychologie (sociale), de la paléontologie, de l’anthropologie, de l’archéologie, de la neurophysiologie, de la psychologie animale et de l’histoire qui plaident en faveur d’une tendance innée de l’être humain à la coopération et à la pacification.
Je me contenterai de relever quelques points qui ont un rapport direct avec notre thème :
– L’agressivité en soi, dérivée du latin « aggredere » = aller vers quelqu’un ou quelque chose, s’attaquer à quelque chose, n’est pas seulement une chose mauvaise, mais un élément vital et sain de notre répertoire d’actions. C’est seulement grâce à elle que la démarcation, l’affirmation de soi et la défense sont possibles. Dès le début de notre vie, nous avons besoin de cette capacité pour nous frayer un chemin à travers le canal étroit de la naissance et venir au monde. Les animaux comme les êtres humains possèdent cette capacité d’agressivité saine. Elle est toujours liée à des situations menaçantes ou à des défis. Les hypothèses d’une pulsion d‘agressivité (Konrad Lorenz) ou même d’une pulsion de mort (Sigmund Freud) sont des spéculations sans fondement.[78]
– Dans certaines circonstances, un comportement agressif peut également être associé à la destruction, par exemple lorsqu’un lion tue une antilope ou lorsque des personnes tuent en état de légitime défense. Mais chez les animaux comme chez les personnes psychologiquement saines, cette destruction n’est jamais une fin en soi.
– Ni les animaux ni les personnes psychologiquement saines ne se comportent de manière sadique, délibérément hostile à la vie ou avec une brutalité jouissive. Seuls les êtres humains rendus destructeurs et donc gravement perturbés psychologiquement veulent la guerre.
– L’être humain est capable d’anticiper mentalement des menaces vitales réelles ou imaginaires, simplement suggérées. Ces dernières peuvent également déclencher chez lui une agressivité ou une destructivité d’origine biologique, servant à la préservation de l’espèce ou à l’instinct de conservation. Ceci a été – et est encore – largement utilisé par les élites au pouvoir pour créer un état de préparation à la guerre dans les masses.
– Une existence jugée sensée, des relations interpersonnelles épanouies, mais aussi une psychothérapie approfondie peuvent aider à atténuer ou à guérir les effets d’une socialisation conduisant à la destructivité.[79]
Le fait que nous venions au monde en tant que tueurs potentiels peut également être vérifié à partir de parcours individuels. Les biographies de personnes ayant commis des crimes aussi graves que le déclenchement d’une guerre ou un génocide sont particulièrement révélatrices à cet égard.
Goebbels
Joseph Goebbels,[80] né en 1897, est devenu ministre de la Propagande nazie et l’un des principaux responsables de la propagande anti-juive, anticommuniste et antisoviétique de l’État nazi.
Enfant et adolescent enthousiaste, Goebbels écrivait des poèmes, des pièces de théâtre et des morceaux pour piano, lisait entre autres Gottfried Keller, Theodor Storm, Schiller et Goethe, tombait amoureux et espérait une vie pleine d’amour et de reconnaissance. Le fait que cet espoir s’estompait à vue d’œil était en partie dû à son pied bot, apparu dans son enfance, ou plutôt aux réactions négatives que ce handicap suscitait. Pour ses parents, catholiques stricts, il s’agissait d’une « malédiction » qu’il valait mieux nier. Il provoquait l’aversion, voire le dégoût, chez ses proches et ses camarades de classe, puis plus tard chez certaines femmes qu’il désirait.
Avec le temps, l’amour pour les autres inassouvi fut remplacé par un objet de substitution, la « patrie ». Mais en 1919, alors qu’il était un jeune homme de 22 ans aux opinions nationalistes, Goebbels posa avec succès sa candidature pour un doctorat auprès d’un professeur juif, qu’il jugea « extrêmement aimable » et « prévenant ».[81] En 1920, il commentait ainsi le soulèvement populaire « de gauche » initialement victorieux en Allemagne de l’Ouest contre les corps francs réactionnaires et la Reichswehr : « Révolution rouge dans la Ruhr […]. Je suis enthousiaste, même de loin ».[82]
À la recherche d’un « génie » qui pourrait le sauver, lui et l’Allemagne, il entendit parler pour la première fois d’Adolf Hitler en 1921 – et fut déçu. Il écrivit : « Quand je vois une croix gammée, j’ai envie de vomir. »[83]
Mais les frustrations professionnelles et privées, le chômage, la faim, l’insécurité existentielle s’ensuivirent[84] et les problèmes psychologiques s’accumulèrent : sentiment d’absurdité, pensées suicidaires, alcoolisme, dépressions nerveuses. Il alternait désormais entre « phases de profonde dépression » et « accès de volonté fanatique ».[85]
En 1922, il apprit que sa fiancée était « à moitié juive ». Bien que déconcerté, il ne mit pas fin à leur relation dans un premier temps.[86] En 1924, il voyait encore des aspects positifs dans « Le Capital » de Karl Marx.[87]
Mais peu à peu, il tomba complètement sous le charme de l’idéologie nazie et du culte du Führer, notamment parce qu’ils lui permettaient de réprimer ses sentiments d’infériorité et sa dépression. Maintenant, pour lui, comme il l’a écrit, « [d]ans le ciel, un nuage blanc s’est formé en croix gammée ».[88] Le disciple inconditionnel d’Hitler était né.
Ce processus dura toutefois près de 30 ans.
Hitler

Peu de personnes ont fait l’objet d’autant de publications qu’Adolf Hitler. En 2020, un livre rassemblant les connaissances actuelles sur son enfance et sa jeunesse est venu s’ajouter à la liste : Hitler – Prägende Jahre (Hitler – Les années formatrices).[89]
On y apprend une fois de plus que l’adolescent Hitler était manifestement de plus en plus marqué par des problèmes d’estime de soi compensés par des idées de grandeur ; son acharnement, son entêtement et son agressivité verbale s’intensifiaient également. Cela n’avait toutefois rien d’étonnant ni de rare à une époque où les enfants et les adolescents étaient soumis à une répression parfois brutale, dont lui-même avait fait les frais.
De plus, Hitler a longtemps su conserver une autre facette de sa personnalité, à savoir une grande sensibilité émotionnelle. Le médecin juif Eduard Bloch, qui avait tenté en vain de sauver la mère de Hitler, alors âgé de 18 ans, d’un cancer, a décrit des décennies plus tard comment il avait perçu le fils le jour de la mort de sa mère :
« Adolf, dont le visage reflétait l’épuisement d’une nuit blanche, était assis à côté de sa mère. Afin de garder une dernière image d’elle, il l’avait dessinée […]. Au cours de ma carrière, je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi détruit par le chagrin qu’Adolf Hitler. […] Personne n’aurait pu imaginer à l’époque qu’il deviendrait un jour l’incarnation même de toute la méchanceté. »[90]
On ne peut donc pas prétendre que Goebbels ou Hitler soient nés monstres, dotés d’un « instinct guerrier » inné.
D’ailleurs, l’étude des soldats permet parfois de nourrir l’espoir. L’expert militaire américain Dave Grossman prouve que « le plus grand défi des armées consiste à surmonter la répugnance des soldats à tuer d’autres êtres humains ». Cette « inhibition à tuer » ne peut être surmontée que par « un entraînement intensif et ciblé ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains étaient si peu préparés à tuer « que seuls 15 à 20 % des fantassins ont tiré un seul coup ».[91]
Conclusion
1) L’affirmation selon laquelle les êtres humains ont toujours fait la guerre est dénuée de tout fondement scientifique, peu sérieuse et trompeuse.
2) La question de savoir si nous sommes des « guerriers nés », si « l’aptitude à la guerre » fait partie de la nature humaine, peut très bien être étudiée scientifiquement – et recevoir une réponse claire et nette : NON.
Quiconque a des enfants ou est en contact suffisamment étroit avec de jeunes enfants peut également se demander s’il les perçoit comme agressifs sans raison, voire destructeurs, comme des « guerriers nés » prêts à tuer. Il existe aujourd’hui de nombreuses découvertes issues de différentes branches scientifiques qui prouvent que nous venons au monde avec le potentiel d’adopter un comportement prosocial, d’aimer, d’être en amitié, de coopérer et d’être pacifiques.[92]
Et ce potentiel ne demande qu’à s’exprimer ! Même les politiciens qui provoquent aujourd’hui à nouveau la guerre et les massacres, et même ceux qui commettent ces meurtres, sont venus au monde il y a quelques années en tant que personnes bonnes.
En d’autres termes, nous avons tous les conditions nécessaires pour être de bonnes personnes au sein d’une bonne société.
Sur cette base, il est possible d’émettre une hypothèse plausible sur les débuts de l’humanité. Une thèse aujourd’hui acceptée par de nombreux scientifiques est qu’il faut supposer une « unité psychique » pour tous les représentants de l’espèce Homo sapiens – à laquelle on peut sans doute ajouter les Néandertaliens. En d’autres termes, depuis que l’homme « moderne » existe, il dispose de dispositions psychiques similaires. Graeber et Wengrow[93] écrivent « qu’un homme qui vit de la chasse à l’éléphant ou de la cueillette de boutons de lotus peut être tout aussi analytique, critique, sceptique et imaginatif que quelqu’un qui gagne sa vie comme chauffeur routier, restaurateur ou directeur d’un département universitaire ».
On peut donc supposer que nos lointains ancêtres humains n’étaient pas plus belliqueux que nous le sommes dès la naissance.
Et aujourd’hui ?
Si nous avons le potentiel d’être de bonnes personnes dans une bonne société, pourquoi ce potentiel ne se développe-t-il pas ?
C’est parce que nous ne vivons pas dans une bonne société.
Les enfants ne valent en aucun cas moins que les adultes. Mais contrairement à ces derniers, ils n’ont guère la possibilité de décider eux-mêmes de leurs conditions de vie. Dans un monde comme le nôtre, marqué par des hiérarchies autoritaires, l’exploitation, l’oppression, le contrôle familial et étatique et la destruction de l’environnement, il y a peu de place pour l’épanouissement d’enfants en bonne santé mentale.
Les souffrances et les privations qui en résultent pour eux, leurs besoins souvent insuffisamment satisfaits, provoquent de la tristesse, de la douleur et de la colère – qui, en règle générale, ne peuvent être exprimées de manière adéquate à l’égard des personnes qui les éduquent. Ils s’accumulent donc jusqu’à atteindre des proportions destructrices, qui sont ensuite renforcées par les humiliations subies à l’école, dans la formation, dans la sphère professionnelle et au travail. Comme ces sentiments refoulés ne peuvent généralement pas s’exprimer officiellement, sauf si l’on devient soldat par exemple, ils sont dissimulés derrière une façade d’adaptation sociale, de politesse et de gentillesse. C’est ainsi que se forme, encore aujourd’hui, le « caractère autoritaire », qui s’incline devant les supérieurs et écrase les subordonnés.[94]
Et cela a des conséquences extrêmement préoccupantes pour l’ensemble du tissu social. Non seulement ces émotions destructrices sont présentes en permanence de manière latente, mais elles peuvent aussi surgir à tout moment, dès qu’une occasion se présente. Cela est d’autant plus facile lorsque les médias et la politique fournissent des cibles faciles sous la forme de personnes socialement défavorisées ou d’« étrangers » diabolisés. En Allemagne, il s’agissait autrefois des Juifs, des communistes et des Russes, et aujourd’hui, ce sont à nouveau les Russes, et bientôt sans doute aussi les Chinois.[95]
C’est ainsi, à travers la socialisation massive de structures psychiques destructrices et la manipulation médiatique, que l’on a tenté et que l’on tente encore de dresser les gens à la « guerre ». Plus nous sommes rendus agressifs et dévalorisés, plus nous sommes utilisables à toutes sortes de fins destructrices, qu’elles soient déguisées sous des idéologies nationalistes, néofascistes, fondamentalistes, impérialistes, destructrices de l’environnement, hostiles aux enfants, aux femmes, aux homosexuels ou aux étrangers.
Si l’on offre un exutoire à la colère explosive accumulée par les masses, les opinions deviennent interchangeables : le terrorisme et le meurtre peuvent être commis sous le prétexte d’une idéologie « de droite » ou « de gauche », pour la gloire de Dieu, pour le salut d’Allah, au nom d’une dictature écologique ou, comme c’est le cas actuellement, dans le cadre d’un projet néolibéral occidental « fondé sur des règles » visant à rendre le monde heureux.

Le psychanalyste Wilhelm Reich a décrit ce processus fondamental en 1933 dans son ouvrage Psychologie de masse du fascisme : la répression des enfants les rend « craintifs, timides, craintifs envers l’autorité, dociles et éducables au sens bourgeois du terme ». Les enfants passent d’abord par « l’État miniature autoritaire qu’est la famille […] afin de pouvoir s’intégrer plus tard dans le cadre social général ». L’énergie vitale refoulée, qui ne peut plus s’exprimer naturellement après avoir subi ce processus éducatif, cherche alors des exutoires de substitution, se transforme en agressivité naturelle et s’intensifie ainsi « en un sadisme brutal qui constitue un élément essentiel de la base psychologique de masse de la guerre mise en scène par une poignée d’individus pour servir des intérêts impérialistes ». L’individu ainsi psychologiquement déformé « agit, ressent et pense » à l’encontre de ses intérêts vitaux.[96]
C’est ainsi que nous sommes FAITS pour devenir des « guerriers ».
Mais comme il est dans notre nature d’être pacifiques, solidaires et prosociaux – nous ne pouvons pas être « humains » sans les autres, ni exister sans eux au début de notre vie –, être conditionnés à être « aptes au combat » nous rend malades.
Alternatives, perspectives
La question reste posée : que faut-il faire pour que les êtres humains redeviennent aussi pacifiques qu’ils semblent être à leur naissance – ou, mieux encore, pour qu’ils puissent rester aussi pacifiques ?
Comme je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet,[97] je serai très bref.
Nous avons toujours besoin d’un bouleversement des conditions économiques et politiques, d’une sortie de notre structure sociale néolibérale et capitaliste de plus en plus destructrice. Mais cela ne suffit pas, comme l’a montré en particulier l’expérience finalement infructueuse du « socialisme réel ». Il faut y ajouter une révolution psychosociale.
Wilhelm Reich a résumé en 1934 le lien qui existe entre ces deux éléments :
« Si l’on tente de changer uniquement la structure des individus, la société s’y oppose. Si l’on tente de changer uniquement la société, les individus s’y opposent. Cela montre qu’aucun des deux ne peut être changé isolément. »[98]
Pour notre époque, cela pourrait se concrétiser ainsi : les adultes devraient – notamment en recourant à la psychothérapie – travailler sur leurs troubles psychiques acquis par la socialisation et veiller en même temps à épargner à leurs enfants et petits-enfants le développement de ces troubles.

Le psychanalyste Hans-Joachim Maaz a introduit – notamment dans son livre Der Gefühlsstau[99] – un concept correspondant de « culture thérapeutique » lors de la chute du mur de Berlin, qu’il a depuis développé pour devenir la « culture relationnelle »[100].
Accompagner les enfants avec amour dans la vie, rechercher activement des partenariats équitables et épanouis, une sexualité épanouie et une bonne santé mentale, dénoncer les normes autoritaires, hostiles à la vie, voire bellicistes, dans la sphère privée et publique, que ce soit dans la famille, à l’école, au travail, dans les médias, l’Église, la politique et l’État, et rechercher des personnes partageant les mêmes idées avec lesquelles il est possible de s’y opposer – tout cela a depuis lors gagné en importance et en actualité.[101]
La description la plus concise de l’objectif à long terme de ces efforts est celle d’Erich Fromm : une « société saine » « dans laquelle personne ne doit plus se sentir menacé : ni l’enfant par ses parents, ni les parents par leurs supérieurs, ni une classe sociale par une autre, ni une nation par une superpuissance ».[102]
***
Notes et sources
[1] Une version antérieure de cet article a été publiée en 2023 sur mon site web et en 2025 sur apolut (https://apolut.net/sind-wir-geborene-krieger/). L’échange fructueux avec le préhistorien et spécialiste en sciences culturelles Martin Kuckenburg a largement contribué à la révision de mon article.
Comme je m’inspire ici de différents domaines scientifiques pour lesquels je n’ai pas de qualification particulière et que j’utilise principalement des sources secondaires, je recommande de se faire sa propre opinion à l’aide des livres mentionnés dans le texte et de rechercher régulièrement des mises à jour sur Internet, en particulier en ce qui concerne les découvertes archéologiques.
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg#Ebenen_der_Kriegsf%C3%BChrung.
[3] « La guerre est le père de tous, le roi de tous. Elle fait des uns des dieux, des autres des hommes, des uns des esclaves, des autres des hommes libres » (https://de.wikipedia.org/wiki/Heraklit).
[4] « Je montrerai d’abord que l’état des hommes sans société civile (état que l’on peut appeler état de nature) n’est autre qu’une guerre de tous contre tous, et que dans cette guerre, tous ont droit à tout » (https://de.wikipedia.org/wiki/Bellum_omnium_contra_omnes).
[5] Sigmund Freud (1930) [1929] : Le malaise dans la civilisation, dans : GW Band 14, Fischer, p. 419-506, ici p. 471. À propos du fait que Freud se réfère à tort à Hobbes et diffame les loups, voir : https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/der-mensch-ist-dem-menschen-kein-wolf-ueber-eine-eklatante-freudsche-fehlleistung/.
[6] Depuis mai 2016, Obama était « officiellement le président américain ayant connu le plus grand nombre de jours de guerre ». Sous son gouvernement, les États-Unis avaient alors mené « au total 2 663 jours de guerre » (https://www.spiegel.de/panorama/krieg-barack-obama-ist-der-us-praesident-mit-den-meisten-kriegstagen-a-00000000-0003-0001-0000-000000567071). De plus, « les assassinats par drones sont devenus une doctrine d’État, chaque semaine, il signait la « liste des personnes à abattre » (https://www.deutschlandfunkkultur.de/drohnenkrieg-obamas-toedliches-erbe-100.html), qui a fait plusieurs milliers de victimes innocentes, considérées comme des « dommages collatéraux ».
[7] https://www.welt.de/politik/ausland/article5490579/Seine-Rede-zum-Friedensnobelpreis-im-Wortlaut.html.
[8] https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/warum-gibt-es-noch-immer-kriege/ Je n’ai pas pu retrouver cet article en mars 2025 sur le nouveau site web de l’institut.
[9] Ibid.
[10] Martin Kuckenburg (1993) : Siedlungen der Vorgeschichte in Deutschland, 300000 bis 15 v. Chr. (Les sites préhistoriques en Allemagne, de 300 000 à 15 avant J.-C.), Dumont, p. 10.
[11] https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen#Entwicklungsgeschichte. Le site https://de.wikipedia.org/wiki/Hominisation parle de cinq à sept millions d’années, tandis que le site https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte_des_Menschen mentionne 7,9 millions d’années. Il est très spéculatif de vouloir tirer des conclusions sur les dispositions psychosociales des humains actuels à partir du comportement des chimpanzés (et des bonobos) d’aujourd’hui : En six millions d’années d’évolution indépendante, beaucoup de choses ont pu changer, chez les deux espèces. L’anthropologue R. B. Ferguson a mené des recherches sur les études qui attribuent aux chimpanzés actuels le statut de « singes tueurs », souvent interprété comme un héritage de l’humanité. Résultat : sur les 27 cas de meurtres entre congénères enregistrés ou présumés sur 18 sites de recherche sur les chimpanzés « au cours de 426 années d’observation sur le terrain », « 15 proviennent de seulement deux situations fortement conflictuelles […]. Les 417 années d’observation restantes donnent une moyenne de seulement 0,03 meurtre par an ». De plus, Ferguson estime probable que ces conflits mortels « ne constituent pas une stratégie évolutive, mais une réaction à l’intervention humaine » dans l’habitat des chimpanzés (https://www.scientificamerican.com/article/war-is-not-part-of-human-nature/ traduction A.P. Cf. Martin Kuckenburg, 1999 : Lag Eden im Neandertal? Auf der Suche nach den frühen Menschen, Econ, p. 154 et suivantes).
[12] https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte_des_Menschen.
[13] https://www.mpg.de/11820357/mpi_evan_jb_2017. Mais : étant donné qu’il existe « un large éventail de variations dans l’apparence des hommes actuels », « il n’y a pas de consensus sur ce que sont les hommes « modernes » et quand ils apparaissent pour la première fois dans les découvertes fossiles » (G. J. Sawyer/ Viktor Deak : Der lange Weg zum Menschen. Lebensbilder aus sieben Millionen Jahren Evolution, Spektrum 2008, p. 174). Les découvertes relatives aux hominidés préhumains sont de plus en plus floues. Souvent, des ossements dont l’âge varie de plusieurs centaines de milliers d’années ou dont les sites de découverte sont distants de plusieurs milliers de kilomètres sont assemblés pour (re)construire les espèces hominidées supposées (ibid., p. 13 et suivantes). Le très célèbre « homme de Denisova », par exemple, serait « attesté avec certitude », outre par l’analyse ADN, par une phalange (âge : 48 000 à 30 000 ans), une phalange de pied (âge : 130 000 à 90 900 ans), deux molaires (l’une datant de plus de 50 000 ans, l’autre de moins de 50 000 ans), tous trouvés à la frontière avec le Kazakhstan, ainsi que par une mâchoire inférieure excavée au Tibet chinois (âge : 160 000 ans) (https://de.wikipedia.org/wiki/Denisova-Mensch ; https://www.mpg.de/5018113/denisova-genom).
[14] https://www.planet-wissen.de/natur/energie/feuer/index.html
[15] James C. Scott (2019) : Les moulins de la civilisation. Une histoire profonde des premiers États, Suhrkamp, p. 20, cf. Hannes Stubbe (2021) : Weltgeschichte der Psychologie (Histoire mondiale de la psychologie), Pabst, p. 27.
[16] David Graeber/ David Wengrow (2021) : Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit, Klett-Cotta, p. 96, 98. Kuckenburg (voir note 11, p. 13-15) décrit de manière très similaire les handicaps de l’archéologie et de la paléoanthropologie.
[17] Harald Meller, Kai Michel, Carel van Schaik (2024) : Die Evolution der Gewalt. Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen (L’évolution de la violence. Pourquoi nous voulons la paix, mais faisons la guerre), dtv, p. 136.
[18] Ibid., p. 152.
[19] https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wissen/acht-milliarden-menschheit-wachstum-e418385/ Concernant les hypothèses sur les fluctuations violentes des populations préhistoriques, voir : https://science.orf.at/stories/3221020/.
[20] Étant donné que les découvertes de fragments de squelettes sont de plus en plus rares à mesure que le temps passe, le nombre total n’augmente pas de manière significative si l’on dépasse le cercle de l’Homo sapiens. De même, sur les « millions de Néandertaliens » qui auraient vécu au total, « seuls les restes de deux à trois cents individus » ont été découverts à ce jour (Rebecca Wragg Sykes, 2022 : Der verkannte Mensch. Ein neuer Blick auf Leben, Liebe und Kunst der Neandertaler, Goldmann, p. 63).
[21] Graeber/ Wengrow (voir note 16), p. 100 et suivantes. La méthode du radiocarbone, souvent utilisée pour la datation, ne fonctionne également que pour les 60 000 dernières années : https://de.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonmethode.
[22] https://science.orf.at/stories/3219658/
[23] Voir Stubbe (comme note 15), p. 15-67.
[24] Christopher Ryan/ Cacilda Jethá (2016) : Sex. Die wahre Geschichte, Klett-Cotta, p. 223.
[25] https://www.researchgate.net/figure/Cranium-17-bone-traumatic-fractures-A-Frontal-view-of-Cranium-17-showing-the-position_fig4_277326376 ; https://www.20min.ch/story/cranium-17-das-aelteste-mordopfer-der-geschichte-162218687169.
[26] Meller et al (voir note 17), p. 146.
[27] Ibid., p. 139.
[28] https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg.
[29] Ibid.
[30] R. Brian Ferguson, « The Birth of War » (https://www.naturalhistorymag.com/htmlsite/0703/0703_feature.html). Traduction A.P.
[31] https://www.scinexx.de/news/geowissen/kein-steinzeit-krieg-in-jebel-sahaba/.
[32] Dirk Husemann (2005) : Als der Mensch den Krieg erfand, Thorbecke, p. 34.
[33] Comme dans la note 31.
[34] Husemann (voir note 32), p. 34. Meller et al (voir note 17), p. 154 et suivantes, avancent le même argument.
[35] Ibid., p. 155.
[36] Wragg Sykes (voir note 20), p. 25. Il semble aujourd’hui largement admis que la thèse selon laquelle l’Homo sapiens aurait exterminé les Néandertaliens ne tient pas la route. Voir ibid., p. 451-454 ; Martin Kuckenburg (2005) : Der Neandertaler. Auf den Spuren des ersten Europäers, Klett-Cotta, p. 282-296 ; Meller et al (comme note 17), p. 142.
[37] Meller et al (comme note 17), p. 146f., 162.
[38] Il y a 35 000 ans, la population mondiale aurait été de trois millions d’individus au maximum (Scott, comme note 15, p. 22).
[39] Ryan et Jethá (comme note 24, p. 201) parlent de « société d’abondance primitive ». Cette expression s’inspire de l’essai de Marshall Sahlins « The original affluent society » : https://www.uvm.edu/~jdericks/EE/Sahlins-Original_Affluent_Society.pdf (voir également : https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/die-urspruengliche-wohlstandsgesellschaft.html). Bien sûr, il y avait déjà à l’époque des fluctuations climatiques qui ont conduit, par exemple, à des périodes glaciaires. Mais en règle générale, celles-ci se sont produites si lentement que l’adaptation était possible (Wragg Sykes, comme note 20, p. 104-124). L’hypothèse d’une extinction quasi totale de l’humanité à la suite d’une éruption volcanique il y a plus de 70 000 ans est très controversée (https://de.wikipedia.org/wiki/Toba-Katastrophentheorie).
[40] Rutger Bregman (2020) : Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit (Fondamentalement bons. Une nouvelle histoire de l’humanité), Rowohlt, p. 115. La plus ancienne peinture rupestre connue date de 45 000 ans (https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hlenmalerei).
[41] https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Kilianst%C3%A4dten, https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Halberstadt, https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Talheim, https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Schletz ; https://www.scinexx.de/news/archaeologie/war-dies-der-erste-krieg-europas/.
[42] https://de.wikipedia.org/wiki/Felsmalereien_in_der_spanischen_Levante. Voir également Husemann (comme note 32), p. 61 et suivantes.
[43] Les premières traces de l’utilisation d’armes pour la chasse remontent à environ 500 000 ans (https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/fruehmenschen-jagten-schon-vor-500000-jahren-mit-stein-speerspitzen-a-867412.html). Les seules armes de chasse « incontestablement attestées » sont des lances vieilles de 300 000 ans, qui ont été retrouvées à Schöningen, en Basse-Saxe, parmi les ossements de nombreux chevaux sauvages abattus avec ces armes (Martin Kuckenburg, 2022 : Friedrich Engels‘ Frühgeschichte und die moderne Archäologie, sans lieu, p. 79). Mais pouvoir chasser des animaux avec ces armes ne signifie pas vouloir tuer des êtres humains. En 2025, après avoir utilisé une méthode de datation controversée, l’âge des lances a été estimé à seulement 200 000 ans (https://www.welt.de/wissenschaft/article256093064/Archaeologie-Die-Schoeninger-Speere-sind-100-000-Jahre-juenger-mit-Folgen.html).
[44] Cf. Scott (comme note 15), p. 159-164.
[45] Brigitte Röder/ Juliane Hummel/ Brigitta Kunz (2001) [1996] : Göttinnendämmerung. Das Matriarchat aus archäologischer Sicht, Königsfurt, p. 396. Voir également Graeber/ Wengrow (cf. note 16), p. 238-244.
[46] Scott (voir note 15), p. 20. Voir également https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Schrift. Pour plus de détails à ce sujet, voir Martin Kuckenburg (2016) : Wer sprach das erste Wort? Die Entstehung von Sprache und Schrift, Theiss.
[47] Bregman (voir note 40), p. 139-161.
[48] Kuckenburg (voir note 36), p. 9.
[49] https://de.wikipedia.org/wiki/Neandertaler#Verwandtschaft_zum_modernen_Menschen.
[50] Stubbe (voir note 15), p. 33.
[51] Cela ne signifie pas nécessairement – mais cela peut signifier – qu’ils étaient plus intelligents que nous (cf. ibid., p. 25).
[52] Voir notamment les notes 16 et 36.
[53] R. Brian Ferguson (2013) : Pinker’s List: Exaggerating Prehistoric War Mortality, dans Douglas P. Fry (éd.) : War, Peace, and Human Nature, Oxford University Press, p. 112-131 (https://www.researchgate.net/publication/273371719_Pinker’s_List_Exaggerating_Prehistoric_War_Mortality). Voir également Ryan/ Jethá (cf. note 24), p. 212-215 et Bregman (cf. note 40), p. 112 et suivantes.
[54] Meller et al (cf. note 17), p. 37.
[55] https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/wird-alles-immer-besser-ein-kritischer-blick-auf-steven-pinkers-geschichtsoptimismus/.
[56] https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Chagnon.
[57] Ryan/ Jethá (voir note 24), p. 223-227 ; Bregman (voir note 40), p. 111 et suivantes.
[58] Bregman (voir note 40).
[59] En anthropologie, faute de vestiges préhistoriques exploitables, il n’est pas rare que l’on se base sur des traditions transmises au cours des derniers millénaires ou sur des observations de terrain réalisées jusqu’à nos jours par des chasseurs et des cueilleurs pour tirer des conclusions sur le mode de vie des premiers Homo sapiens. Mais il ne s’agit là encore que de spéculations. D’autant plus qu’il n’existe aujourd’hui pratiquement plus d’ethnies complètement coupées du reste du monde. Cf. Martin Kuckenburg (2022) : Friedrich Engels‘ Frühgeschichte und die moderne Archäologie, sans lieu, p. 136 et suivantes.
[60] https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes.
[61] Meller et al (comme note 17), p. 113.
[62] Ryan/ Jethá (comme note 24), p. 204, 236, p. 238.
[63] Meller et al (comme note 17), p. 113.
[64] https://www.researchgate.net/publication/250920560_Lethal_Aggression_in_Mobile_Forager_Bands_and_Implications_for_the_Origins_of_War.
[65] Ibid., p. 272. Traduction A.P.
[66] https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsentstehung.
[67] Scott (voir note 15), voir également https://www.soziopolis.de/die-muehlen-der-zivilisation-1.html.
[68] https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%87atalh%C3%B6y%C3%BCk.
[69] Graeber/ Wengrow (comme note 16), p. 236, 245ff.
[70] https://www.uncg.edu/employees/douglas-fry/.
[71] https://sustainingpeaceproject.com/.
[72] https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_can_we_learn_from_the_worlds_most_peaceful_societies. Traduction A.P.
[73] Ibid.
[74] Douglas P. Fry (2005) : The Human Potential for Peace: An Anthropological Challenge to Assumptions about War and Violence, Oxford University Press ; https://sustainingpeaceproject.com/.
[75] Erich Fromm (1989) : Die Anatomie der menschlichen Destruktivität, dans : Gesamtausgabe, vol. 7, dtv
[76] Ibid., p. 148-262. En 1998 encore, l’atlas ethnographique recensait 160 « peuples et ethnies indigènes » « purement matrilinéaires », c’est-à-dire ne tenant compte que de la descendance maternelle. Cela représentait tout de même environ 13 % des 1 267 ethnies recensées dans le monde (https://de.wikipedia.org/wiki/Matriarchat).
[77] Fromm (comme note 75), p. 158 et suivantes.
[78] Pour en savoir plus : https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/wp-content/uploads/2018/07/Mythos-Todestrieb-pid_2018_02_Peglau.pdf.
[79] Mon travail thérapeutique me prouve également que cela est possible, que les êtres humains peuvent surmonter des influences destructrices.
[80] Voir Goebbels, Joseph (1992) [1990] : Tagebücher 1924-1945 (Journal intime 1924-1945) en cinq volumes, édité par Reuth, Ralf Georg, Piper ; Longerich, Peter (2010) : Goebbels. Biographie, Siedler ; Reuth, Ralf G. (1991) [1990] : Goebbels, Piper, voir notamment les pages 11 à 75.
[81] Ibid., p. 52.
[82] Ibid., p. 47.
[83] Ibid., p. 52.
[84] Ibid., p. 68-73.
[85] Ibid., p. 63.
[86] Ibid., p. 73.
[87] Longerich (voir note 80), p. 58.
[88] Reuth (voir note 80), p. 104.
[89] Hannes Leidinger/ Christian Rapp (2020) : Hitler – Prägende Jahre. Kindheit und Jugend 1889–1914, Residenz. Voir également : Brigitte Hamann (1998) : Hitlers Wien : Lehrjahre eines Diktators, Piper.
[90] Ibid., p. 152. Pour plus de détails : Brigitte Hamann (2010) : Hitlers Edeljude : Das Leben des Armenarztes Eduard Bloch, Piper.
[91] Meller et al (voir note 17), p. 124.
[92] Outre les ouvrages utilisés dans le présent texte, voir Gerald Hüther (2003) [1999] : Die Evolution der Liebe. Was Darwin bereits ahnte und die Darwinisten nicht wahrhaben wollen, Vandenhoeck/Ruprecht ; Mark Solms/Oliver Turnbull (2004) : Das Gehirn und die innere Welt. Neurowissenschaft und Psychoanalyse, Walter, p. 138 et suivantes, 148 ; Michael Tomasello (2010) : Pourquoi nous coopérons, Suhrkamp ; Stefan Klein (2011) [2010] : Der Sinn des Gebens. Pourquoi l’altruisme l’emporte dans l’évolution et pourquoi l’égoïsme ne nous mène nulle part, Fischer ; Joachim Bauer (2015) : Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens (L’autocontrôle. La redécouverte du libre arbitre), Blessing. Le documentaire d’Erwin Wagenhofer publié en 2013, Alphabet – Angst oder Liebe (Alphabet – Peur ou amour), illustre également cela de manière touchante (http://www.alphabet-film.com/).
[93] Comme note 16, p. 114 et suivantes. Voir également Bregman (comme note 40), p. 79 et suivantes.
[94] Cf. : https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00045266/05_Peglau_Autoritarismus.pdf.
[95] Voir également https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/andreas-peglau-utopie-oder-dystopie-zitate-und-notizen-zu-china-mai-2020-bis-oktober-2021/.
[96] Wilhelm Reich (2020) : Psychologie de masse du fascisme. Le texte original, Psychosozial, p. 38, 40.
[97] Par exemple dans Andreas Peglau (2024) : Les hommes comme marionnettes ? Comment Marx et Engels ont refoulé la psyché réelle dans leur enseignement (https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/menschen-als-marionetten-wie-marx-und-engels-die-reale-psyche-in-ihrer-lehre-verdraengten/), p. 70-74 ou ici : https://www.manova.news/artikel/rechtsruck-in-deutschland.
[98] Wilhelm Reich (comme note 96), p. 195.
[99] Voir également : https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/psychische-revolution-und-therapeutische-kultur-vorschlaege-fuer-ein-alternatives-leben/.
[100] Voir : https://hans-joachim-maaz-stiftung.de/hans-joachim-maaz/buecher-von-hans-joachim-maaz/.
[101] Voir également https://apolut.net/im-gespraech-andreas-peglau/.
[102] Erich Fromm (comme note 75), p. 395.
Dernière consultation des sources Internet : 14/05/2025
Veuillez citer comme suit
Andreas Peglau (2025) : Nous ne sommes pas nés guerriers. Des conditions psychosociales de la pacification et de la « bellicosité » (https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/wir-sind-keine-geborenen-krieger-zu-psychosozialen-voraussetzungen-von-friedfertigkeit-und-kriegstuechtigkeit/) Traduction en français.
La transmission et la diffusion de cet article à des fins non commerciales sont expressément souhaitées.
Sous licence Creative Commons (Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification 4.0 International, CC BY-NC-ND 4.0).